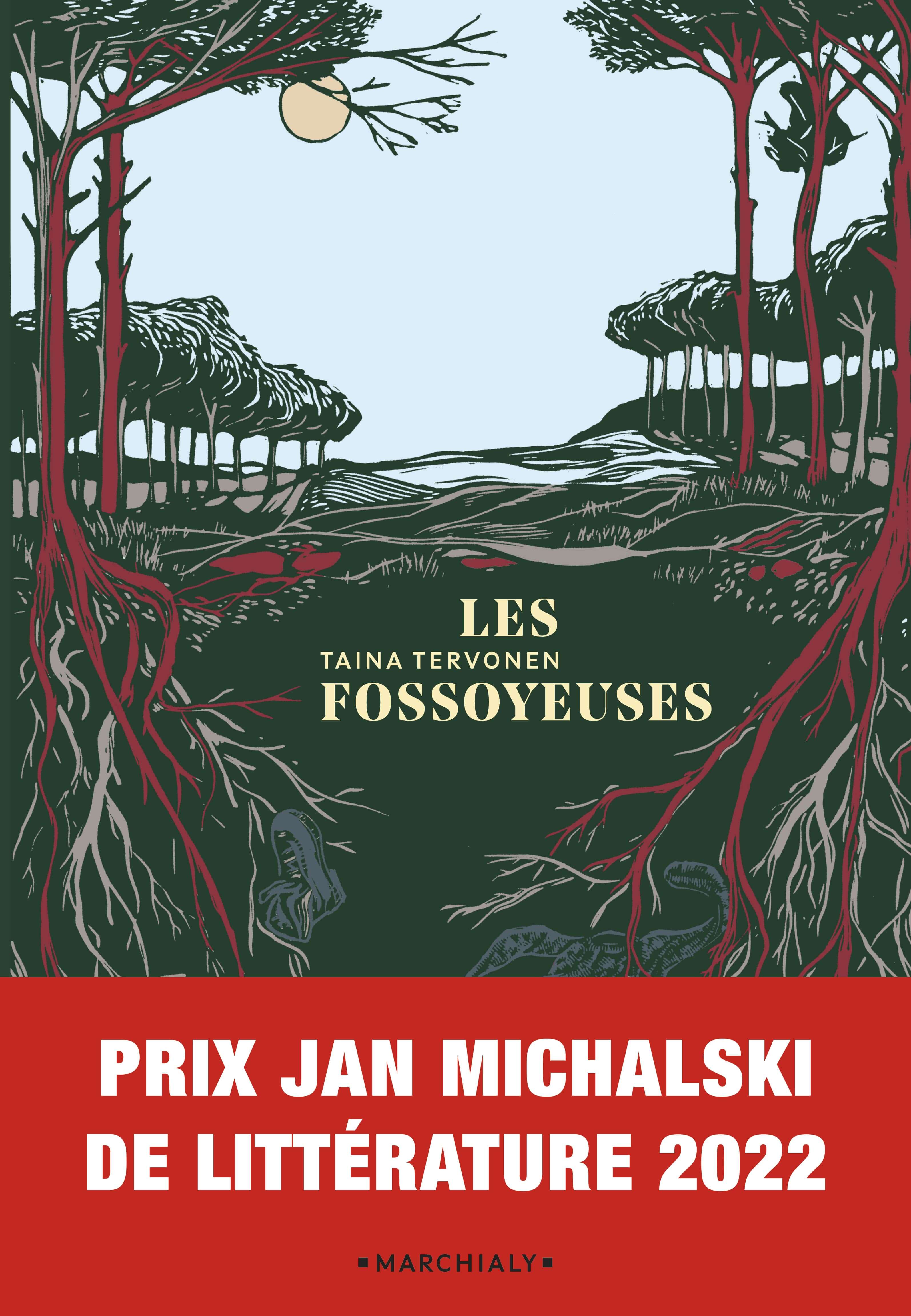La mort sans cannibalisme
Paletó est mort et le récit commence. Ici, Aparedica Vilaça, en fille adoptive et en anthropologue nous raconte les changements de coutumes funéraires chez les Wari’ récemment convertis, comme les souvenirs avec son père avant l’au-delà.
Une fois, Paletó m’a dit que si je mourais, il pleurerait beaucoup, déchirerait les vêtements que je lui avais donnés et les jetterait au feu. Je songe à présent à ce qu’on fera des effets personnels de Paletó, cette sacoche qui ne le quittait jamais, ses habits, cette écharpe rouge que je lui ai donnée il y a un certain temps déjà, ses couvertures, ses shorts. Vont-ils les détruire ? Vont-ils les donner ou les revendre, comme ils ont à présent l’habitude de le faire avec les objets plus durables, comme les radios et les postes de télévision ? Autrefois, cela ne faisait pas débat, m’a dit une fois l’épouse de Paletó, To’o Xak Wa : les seuls objets durables qu’ils possédaient étaient des pots de terre cuite, qu’ils brisaient avant de les jeter dans le feu au-dessus duquel grillait le mort.
Paletó n’avait plus de maison à lui, et très peu d’effets personnels, car il vivait (avec son épouse jusqu’à la mort de celle-ci) tantôt chez l’un de ses enfants, tantôt chez un autre : chacun veillait à tour de rôle à leur bien-être et à leur alimentation. Durant ses dernières années, la maladie de Parkinson l’avait considérablement amoindri. Il racontait toujours que cet affaiblissement découlait d’une chute dans la rivière, un jour qu’il pêchait seul à bord d’une pirogue. Ne sachant pas nager, il avait failli se noyer, et avait été sauvé in extremis par l’un de ses fils. Depuis, il tremblait beaucoup, comme si la froidure de l’eau avait imprégné son corps pour toujours.
Sur les photos que je finis de consulter sur mon ordinateur, prises à l’occasion de ma dernière visite en 2015, on le voit chanter, rire, presque toujours les yeux fermés. Quelle était cette chose qu’il refusait de voir ? Cet homme a vécu au bas mot trente ans au cœur de la forêt, sans le moindre contact avec les blancs, si ce n’est à l’occasion d’échauffourées, et sans rien connaître des bienfaits de notre civilisation, à l’exception des outils et ustensiles en métal trouvés dans les maisons abandonnées par les seringueiros. Il a assisté à l’arrivée des blancs, des maladies, des nourritures étranges et des vêtements. On m’a raconté qu’il avait d’abord refusé de se recouvrir de ce qu’on lui offrait, mais qu’émerveillé par une veste (paletó en portugais du Brésil), il l’avait adoptée, sans rien enfiler d’autre : lui qui jusqu’ici portait le nom de Watakao’ fut dès lors appelé Paletó. Avec sa veste, il a visité d’autres villages, et a découvert la ville de Guajará-Mirim. Il est allé jusqu’à Rio de Janeiro, où il a appris l’existence du téléphone et d’Internet, et je le vois à présent, sur une photo épinglée à mon mur, en train de me parler sur Skype à l’occasion d’un séjour à Guajará-Mirim, chez Gil, auteur de ce portrait. Est-ce que, quand il avait les yeux fermés, ces images du passé lui revenaient ? Fréquemment, il se souvenait d’une anecdote vécue à Rio et il me la rappelait en riant, comme cette fois où il avait vu un hippopotame au Jardin Zoologique, abasourdi d’apprendre qu’on ne mangeait pas ces animaux, ni les pigeons, si nombreux sur nos places, ni même les singes de la forêt de Tijuca. De même, il s’était étonné que je donne à manger à mon fils du poisson cru : je n’avais donc pas peur qu’il se fasse dévorer par un jaguar, attiré par l’odeur du sang ? « Mais il n’y a pas de jaguar en ville, mon père ! » « Ah oui ? Et ces chiens énormes, alors ? Tu crois qu’ils ne sentent pas l’odeur du sang ? »
Comme par le passé, mes parents de Rio Negro vont traverser une longue période de deuil, pleurer et chanter la mélodie funèbre tous les jours, se souvenir dans leur lamentation des actions du défunt, Paletó, de ses attentions, de la nourriture qu’il offrait aux membres de sa famille. Ils ne vont quasiment plus rien manger, ils maigriront et leurs voix deviendront rauques. Jadis, au terme de longs mois, un parent proche décidait de la fin du deuil en invitant l’ensemble des endeuillés à une chasse de plusieurs jours. Ils revenaient avec des paniers chargés d’animaux morts déjà grillés, et pénétraient dans le village à la même heure que celle où le décès était survenu. Ils pleuraient accroupis autour des paniers, de la même façon dont ils pleuraient les morts, chantant la mélodie funèbre et se rappelant les actions du disparu, les petites marques d’attention qu’il leur avait témoignées. Ils pleuraient ce défunt-là, ainsi que d’autres, ceux qu’ils n’avaient pas oubliés. Puis tous mangeaient la viande grillée en riant et en l’appelant « cadavre ». « Tu veux un bout de cadavre ? », demandait un proche en poussant un panier en direction d’un autre parent. Sans bouts de bois, sans le moindre soin. C’était du cadavre, mais à présent, c’était aussi du gibier. Une transformation s’était opérée, et c’était l’objet même de ces réjouissances. Le mort, consommé comme du gibier, quittait enfin le monde des vivants, le souvenir des êtres humains.
Paletó ne sera pas mangé. Peut-être aurait-il préféré cela : les Wari’ avaient la notion d’enterrement en horreur, parce qu’il impliquait que le corps reste sous la terre un très long moment. Mais je sais que Paletó redoutait de ne pouvoir ressusciter et rejoindre les cieux pour vivre au côté de Dieu si son corps ne demeurait pas intact. En 2001, en plein renouveau chrétien à la suite de l’attentat du World Trade Center, auquel ils avaient assisté grâce à la télévision communautaire, et qui avait éveillé chez eux la peur d’une fin du monde imminente, Paletó s’était converti à la religion des missionnaires. Il ne souhaitait plus rejoindre le monde sous l’eau, mais bien le ciel, où iraient tous ceux qui mourraient en chrétiens.
Aujourd’hui, j’aimerais que ce ciel qu’il espérait rejoindre existe, uniquement pour qu’il reçoive Paletó, bien habillé, avec ses chaussures à lacets. Je suis sûre qu’il y susciterait l’admiration de tous, et qui sait, peut-être Dieu lui-même, qui jamais n’apparaît à celles et ceux qui accèdent à son royaume, ferait-il une exception pour l’accueillir.